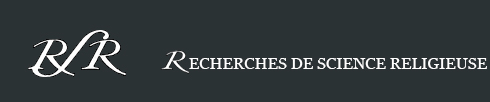Les recherches historiques et exégétiques des trois dernières décennies sur les origines chrétiennes ont conduit à renouveler la question du « Jésus historique » et ont contribué simultanément à transformer l’image du christianisme primitif. Après s’être interrogées sur la possibilité de faire une théologie de la vie de Jésus (RSR 98/4 et 99/1), les Recherches de Science Religieuse voudraient traiter de la « période fondatrice » de l’Église, l’autre versant de la question des origines chrétiennes.
Un des problèmes majeurs de cette reconsidération est la mise en question de la notion théologique (forgée au XIXe siècle par l’École Romaine) de la « mort du dernier apôtre » comme “marqueur” de la clôture de la Révélation. Même la date de 135 n’apparaît plus comme significative du détachement de la matrice juive, le synchronisme entre le débat sur le marcionisme et l’insurrection de Bar Kochba étant artificiel. C’est plutôt un comput par générations qui s’impose aujourd’hui, la génération d’Irénée étant la dernière qui ait reçu une transmission orale de la prédication de Jésus. À la fin du IIe siècle, beaucoup d’éléments sont posés : réseaux de communautés, structuration du réseau épiscopal, martyre comme garant référentiel du christianisme, courant majoritaire d’une définition orthodoxe commune du croire (canon de Muratori), etc. Dans un champ de recherche toujours controversé, d’autres questions sont aujourd’hui posées.
1. Et tout d’abord celle d’une évolution parallèle de l’historiographie juive et chrétienne. Nous ne sommes plus face à deux systèmes monothéistes monolithiques dont l’un dépendant de l’autre s’en serait vite détaché. Dans les deux cas, il s’agit plutôt de communautés diverses, aux interactions multiples et durables, de sorte que christianisme et judaïsme paraissent aujourd’hui avoir construit leur consensus identitaire l’un par rapport à l’autre (Canon), peut-être par mimétisme (martyre), parfois dans la violence. C’est en tout cas une image différente de ce que suggérait l’ancien modèle où le christianisme était issu du judaïsme d’avant 70 ; à cette date, les liens étaient plus durables et plus profonds.
2. Une lecture croisée des apocryphes et des textes canoniques et patristiques, habituelle depuis une trentaine d’années, fait prendre la mesure du filtrage de la transmission des sources dans la tradition chrétienne, une tradition qui a identifié ces sources soit comme des attestations de sa propre origine, soit comme instrument de polémique. Mais en même temps, c’est aussi la possibilité de croiser aujourd’hui des sources, qui permet d’aller au-delà d’une histoire des représentations, celle d’un christianisme d’ « intellectuels virtuoses » (selon le mot de Paul Veyne), et d’envisager les réalités sociales et religieuses contemporaines : pour ce faire, les modèles véhiculés par les apocryphes peuvent alors s’avérer intéressants.
3. Comment le christianisme, longtemps minoritaire, est-il devenu une religion majoritaire ? Le concept de « christianisation » synonyme de conversion est aujourd’hui abandonné. On met plutôt en évidence l’évolution des « modes de vie » ouvrant à la tentative d’écrire l’histoire d’une construction identitaire. La mise en évidence d’une sorte de pluralisme (christianisme théologiquement et institutionnellement divers ; histoire plurielle de christianismes successifs ; christianisme socialement pluriel à un moment donné) pose en effet, en termes nouveaux, le problème de l’identité chrétienne : celle d’un être chrétien changeant, d’une condition dynamique liée au temps, etc. Pour expliquer cette christianisation du monde antique, plusieurs paradigmes, classiques ou récents, sont toujours en débat.
Ce premier numéro du dossier voudrait se tenir à un status questionis, à expliciter dans une livraison ultérieure selon les questions qu’une recherche historique renouvelée pose à une théologie des origines chrétiennes. Faisant fonction d’introduction, un premier article, dû à Michel-Yves Perrin, dessine le cadre épistémologique du présent numéro. Mettant en relief les mutations intervenues dans l’historiographie du christianisme des premiers siècles, il tente de les comprendre dans le cadre d’un dialogue critique avec l’œuvre eusébienne. Sur la base de ce premier repérage, à compléter ultérieurement par l’auteur,
un deuxième article traite des interactions et de l’interdépendance entre judaïsme et christianisme, dans une triangulation où s’impose l’hellénisme de l’époque. Gilles Dorival prend ici à son compte l’intérêt que les historiens portent, depuis une trentaine d’années, à la constitution des identités religieuses comme processus complexe et de longue durée, processus qui repose sur la construction d’une altérité, définie en termes sociétaux et linguistiques. Les trois articles suivants réduisent l’angle de vue en se focalisant sur la
constitution d’une identité chrétienne, sans évidemment quitter le cadre dessiné par les deux premières approches. François-Xavier Romanacce aborde la construction d’une identité commune en insistant sur la tension entre la conviction des communautés dispersées d’appartenir à une Église unique, catholique, et leur revendication d’un attachement à l’identité locale ; ce qui fait comprendre qu’elles posent et maintiennent, tout au long du IIe siècle, des marques de type institutionnel (pratiques liturgiques, structures du clergé, textes canoniques et professions de foi) distinctes, voire opposées. Michel Fédou aborde ensuite, en s’appuyant sur un nombre important de textes, la même question mais du point de vue des modes de vie. Ainsi montre-t-il comment ces figures de l’existence chrétienne ont été perçues à l’extérieur des communautés, comment les chrétiens eux-mêmes les ont interprétées dans la tension entre une authentique conversion et une présence non moins réelle dans la société, comment ils leur ont donné forme, d’un côté, dans le mariage et la famille, et de l’autre, dans le célibat pour le Royaume. Marie-Françoise Baslez, enfin, que je remercie d’avoir collaboré à l’élaboration de ce premier numéro, traite de la diffusion du christianisme du Ier au IIIe siècle dans une perspective anthropologique et sociologique, en croisant la documentation à notre disposition avec une histoire des réseaux. Pour ce faire, elle étudie la pénétration du christianisme dans la cité antique et dans l’Empire, de la sphère privée aux milieux institutionnels et à l’espace public, grâce au phénomène associatif caractéristique du monde
gréco-romain. Ce phénomène se manifeste dans l’Église « de maisonnée », tout en rayonnant dans la mission apostolique qui a d’abord utilisé des réseaux préexistants d’hospitalité et de clientèle, puis a mis rapidement en place des réseaux spécifiquement chrétiens – hospitaliers, financiers, épistolaires, etc. – sur lesquels s’est construite l’unité de l’Église. Ces cinq contributions, on le constatera, ne vont pas sans poser des questions
décisives à la théologie sur sa manière d’envisager aujourd’hui la constitution d’une identité chrétienne et ecclésiale, dans un contexte qui, tout en étant fondamentalement différent, n’est pas sans analogie avec celui des premiers siècles de notre ère. Ainsi devons-nous espérer pouvoir reprendre ces questions dans une livraison ultérieure qui devrait engager des théologiens dans un débat avec historiens, anthropologues et sociologues du christianisme des premiers siècles.
Christoph Theobald