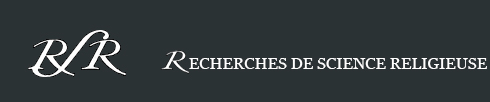L’intitulé du dossier qu’offre ce numéro des RSR paraît relever d’abord de la banalité. Comme écriture précisément, la Bible n’est-elle pas à l’évidence littérature, même si, selon diverses motivations, on la place d’abord sous le signe de l’oralité ? Livres et genres littéraires dans leur diversité disent pourtant et largement que la Bible est bien une littérature, celle d’un peuple et d’une religion qui, dans leur particularité, peuvent s’inscrire, soit historiquement soit esthétiquement, dans le patrimoine de l’humanité.
Mais la Bible est surtout reçue comme un livre “ sacré ” qui, à ce titre, répond d’abord non à l’appel du plaisir ou du désir de culture, mais aux besoins et nécessités d’une foi religieuse, qu’elle soit juive ou chrétienne. Qu’elle ait été unifiée puis “ canonisée ” dans le contexte juif, qu’elle ait été “ reçue ” dans le contexte chrétien, les ensembles qui la constituent le sont d’abord et principalement au nom de ces exigences de foi. Dès lors, au service d’une pratique légaliste et d’une intelligence historique, sa dimension littéraire ne serait qu’externe, accidentelle, ou tout au plus confirmation apologisante de sa sacralité et de sa fonctionnalité.
Pourtant à Babylone les geôliers d’Israël semblaient apprécier de façon très profane la beauté de ses cantiques (Ps 137,3); et le vieil Ezéchiel se plaignait de ce que ses auditeurs, au lieu d’entendre ses appels à la conversion entendait “ comme un chant d’amour, agréablement chanté ” (Ez 33,32).
La littérature, l’appréciation littéraire, feraient-elles courir un risque à la Bible ?
Si risque il y a, il ne fut pas toujours. Entre le mépris de Celse parlant au IIe siècle de “ littérature de gardiens de chèvres ”, et le rejet premier du jeune Augustin au IVe siècle, les commencements chrétiens ne furent pas exclusivement admiratifs de cette littérature venue de l’Orient méditerranéen. Et même si progressivement la Bible s’imposerait comme “ le grand code de l’art ” (W. Blake) à un Occident qui y trouverait prétexte à ses plus grands chefs-d’œuvre tant plastiques que musicaux, le surgissement au XVIIe siècle d’une exégèse dite critique, préoccupée avant tout d’exactitude textuelle, d’historicité et de genres littéraires, ramènerait quelque doute dans la confiance et l’admiration.
Les “ écrivains ” bibliques seraient-ils voués à la négligence sinon au mépris ? Et la Bible ne serait-elle pas l’œuvre d’auteurs authentiques désirant produire des effets d’écriture, et pas seulement stocker ce qu’une insaisissable oralité aurait véhiculé ?
Il faut dire que les trois derniers siècles écoulés, en suite de la double crise de la lecture de la Bible aux XVIe et XVIIe siècles, ont dû le plus souvent parer au plus pressé en se concentrant sur la qualité des manuscrits et des textes, sur les questions d’historicité, de traditions, de sources et de documents. Et l’on sait suffisamment la fécondité de ces siècles pour ne pas insister sur leurs apports.
Mais si la recherche se poursuit, car on n’en aura jamais fini avec les questions que pose le texte, n’est-il pas temps de revenir à ce texte comme écriture, c’est-à-dire comme œuvre consciente d’expression afin de toucher la sensibilité, passage obligé, si l’on peut dire, vers l’intelligence comme vers la conscience religieuse ? Ou ne s’agit-il que de rechercher la beauté dans une sorte de quête d’esthétique, voire de sensualité ? Vers quoi faut-il pencher l’oreille ? Vers un simple air de cithare pour en goûter la qualité ?
C’est de tout autre chose qu’il s’agit : de résoudre l’énigme elle-même, celle qui se concrétise dans les jours de malheur comme dans la méchanceté humaine.
Ainsi a poétisé l’auteur du Psaume 40, engageant, à l’instar d’Ezéchiel, la gratuité de son propre talent au service des exigences et nécessités d’une cause qui, tout à coup, s’avérait digne de beauté, c’est-à-dire de littérature.
Il est donc temps, en ce début du XXIe siècle, de revenir ou de venir à cette “ littérature ” qu’est la Bible, non point par fatigue ou lassitude après tant de travaux critiques, mais par honnêteté envers le texte même et l’époque qui le découvre encore.
Or, depuis une vingtaine d’années, dans le monde des exégètes comme dans celui des critiques littéraires, une sorte de révolution s’est accomplie. Chez les premiers, elle a pu être favorisée par une sensibilité nouvelle aux grandes unités, aux synthèses plus ou moins tardives des livres ou des ensembles de livres ; chez les seconds, sous l’impulsion de critiques littéraires comme Northrop Frye, elle a tenu, en Amérique du Nord notamment, au souci des sources de l’art et en particulier de la littérature. Et même s’il n’y a pas là radicale nouveauté, il y a en tout cas une attention nouvelle, une sensibilité renforcée qui font surgir autrement le texte et le rendent à des lecteurs qui ne pourront qu’en mieux percevoir les différentes virtualités, que leurs attentes soient de type profane, comme on dit, ou qu’elles demeurent religieuses ou spirituelles.
Les articles de ce premier numéro sur “ Bible et Littérature ”, sans prétendre à l’exhaustivité, disent “ l’épreuve du lecteur ” soumis à une autre approche du texte puisqu’il ne s’agit pas moins, ainsi que l’exige l’écrivain Frédéric Boyer, d’atteindre “ l’originalité, voire l’étrangeté, du texte biblique, son statut de texte à énigme ”. Et il ne s’agit pas moins non plus que de s’interroger “ sur le travail du langage poétique, littéraire, à l’œuvre dans la proposition de sens du texte biblique ”.
Paradoxalement, en effet, les contributions de ce dossier vont jouer autour de la question du sens, de l’ “ importance ” véritablement existentielle qu’il y a dans l’approche littéraire de la Bible. Et les “ applications ” que nous voudrions présenter dans un prochain n°, devraient le confirmer.
Ce problème du sens, en conjonction de la superbe qualité d’une écriture, sera concrètement soulevé par les nécessités de traduction qui marquèrent le XVIe siècle des Réformes. En s’attardant sur la traduction de la Bible en français de Sébastien Châteillon, sur ses attendus et ses effets d’écriture, Jacques Roubaud rappelle comment le respect du texte et le respect du lecteur vont de pair dans une véritable création littéraire qui fait de cette traduction un chef-d’œuvre du français, même si elle a été quelque peu oubliée.
Deux articles ensuite, d’Anne Pénicaud et de Robert Alter, nous font entrer dans le domaine des théories et des méthodes d’analyse littéraire. Si la sémiotique n’est pas née dans le champ des études bibliques, on peut dire que depuis une trentaine d’années elle l’a en quelque sorte rattrapé. Son ambition nous a paru correspondre à l’esprit de ce dossier dans le souci particulier de la dimension littéraire qui la caractérise comme méthode d’analyse. Or, “ en s’intéressant à la Bible ”, la sémiotique désirait “ porter la rigueur dans le territoire jusque là le plus réfractaire à une approche scientifique : la Bible considérée exclusivement dans sa dimension littéraire, la Bible en tant que ‘texte seul’ ”.
Parallèlement en quelque sorte, l’article de Robert Alter, dans le cadre de ce dossier, fait paradoxe.
S’affichant comme une critique frontale des thèses de Northrop Frye en matière de littérature comme de Bible, le professeur de Berkeley, lui-même fortement engagé dans l’approche littéraire de la Bible, rappelle explicitement l’intentionnalité majeure de l’écriture biblique telle que la perçoit le “ regard ” du lecteur. Reprochant à l’auteur du Grand Code de ne pas saisir l’élaboration métaphorique qu’il se contente de constater ou d’affirmer, R. Alter rappelle que la vision que Frye a de “ la littérature et de la littérature de la Bible… va à l’encontre de la nature même de toute l’entreprise littéraire de la Bible, qui tend à distinguer strictement l’histoire et la réalisation des possibles de l’humanité, en mettant fortement l’accent sur leur véritable déroulement. ” Car “ notre regard ” se portant “ constamment sur les événements ”, en perçoit la “ portée morale, politique ou d’évidence dans l’articulation complexe du récit ”.
On se souviendra ici du fameux chapitre qui ouvre Mimésis d’E. Auerbach, sur “ la cicatrice d’Ulysse ”. Sans s’engager sur les problèmes d’historicité et s’en tenant aux seuls effets littéraires, Auerbach, comparant la scène du “ sacrifice d’Abraham ” à celle de la reconnaissance d’Ulysse par sa vieille nourrice, montre comment la grande économie de moyens du premier récit tient aux exigences d’une quête de sens qu’ignore le second pris par le seul souci du plaisir du lecteur. Les effets d’écriture, aussi manifestes dans l’un et l’autre cas, se distinguent précisément sur cette question de sens.
On touchera dans ce dossier à des enjeux qui empêchent de réduire le propos au simple retour à une dimension négligée du texte biblique. On s’apercevra vite que le rapport entre Bible et littérature n’est pas simple, même si depuis Richard Simon, au XVIIe siècle, la revendication du “ texte seul ” a constitué la base de toute critique, même si la dimension historique parut d’abord l’emporter.
Autrement dit, l’ouverture de ce dossier est aussi l’ouverture à une question qui est au cœur de toute réception de la Bible. Dans le cadre d’une religion qui repose sur le principe d’Incarnation et pour laquelle le rapport à l’histoire est fondamental, comme dans une culture qui ne peut ignorer les sources et provocations de l’écriture biblique, cette question ne peut longtemps ou toujours être ignorée. Pour Robert Alter elle fait en quelque sorte ligne de partage entre récepteurs du texte biblique, partage dont l’enjeu est rien moins que la question du sens dans sa dimension existentielle. Que la Bible soit une vraie littérature ne peut que confirmer cet enjeu.
Indépendamment, nous proposons un article sur “l’Evangile de la folie sainte ”. Œuvre d’un chercheur en un domaine peu étudié tant il paraît suspect à nos sociétés qui ont tenté de scientifiser au maximum l’angoissant domaine de ce qu’on appelle traditionnellement la folie, il voudrait rappeler à la fois une part de l’expérience religieuse chrétienne qui prend sa source dans le “ scandale de la croix ”, et dans l’objet de ce scandale précisément en quoi le Christianisme s’est aussi fondé.
Je ne puis terminer cet Editorial sans évoquer la figure de celui qui nous a quitté le 23 avril dernier, le Père Paul Beauchamp sj. Il participa pendant plusieurs années au Conseil de rédaction des RSR et assura de nombreux Bulletins d’Ancien Testament. Exégète original, acceptant d’être reconnu, ainsi qu’il me le dit quelques semaines avant sa mort, dans une “ métaexégèse ”, il fut un maître autant qu’un éveilleur d’idées. Plus que d’une prodigieuse culture, il fut d’une prodigieuse intelligence de la culture. Ayant appris et pratiqué le chinois en Chine, et ne l’ayant jamais oublié, il ne cessait de s’intéresser comme de s’interroger sur ce véritable continent. Sensible à la culture germanique dont il était capable d’apprécier aussi bien l’art baroque que la peinture expressionniste, il n’excluait pas davantage de ses goûts et intérêts un Shakespeare sur lequel nous étions quelques-uns à l’encourager à écrire, au risque de lui provoquer un souriant agacement. Capable d’apprécier non sans humour un poète comme André Chénier, il était prêt à découvrir aussi bien Malrieu que Pierre-Jean Jouve. Reste son œuvre à laquelle une écriture parfois difficile ne fera que rendre plus urgente l’attention qui permettra d’en découvrir les richesses encore insoupçonnées.