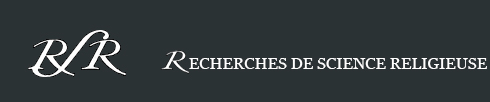Actes du Colloque « Théologie et Sciences Sociales »
par Patrick C. Goujon
À qui observe aujourd’hui la théologie depuis l’université en raison d’un intérêt pour les questions religieuses dans nos sociétés pluralistes, il apparaît souvent une production peu compatible avec les requêtes de la recherche scientifique. Beaucoup de publications se contentent de manières de dire et de penser qui ne trouvent plus de lecteurs en dehors de quelques cercles déjà convaincus ou sans attente d’un recul critique. On rencontre de moins en moins de théologiens informés avec sérieux de l’histoire de l’Église, de la sociologie, pour ne rien dire des sciences et de la médecine, à quelques rares exceptions près. D’autres, au rebours, font mine d’avancer masqués sous les habits du philosophe, du sociologue ou de l’historien. Mais personne ne s’y trompe : ni les universitaires pour qui l’accoutrement est trop grossier, ni ceux que satisfait un essai pour faire taire les sciences sociales. Même si l’université compte des polémistes et des militants, les chercheurs, dans leur ensemble, ne font pas leur carrière sur un succès de librairie peu scrupuleux de la rigueur des méthodes. Enfin, les documents émanant du Saint-Siège ou des Conférences épiscopales rencontrent encore moins l’intérêt universitaire, sauf de ceux qui, et il en est, étudient l’évolution de la place du catholicisme. Il est vrai que ces textes poursuivent d’autres buts, et s’adressent à un plus large lectorat dont il est légitime que des pasteurs aient le souci. Nous avons, par chance, dans l’aire francophone, des sociologues et des historiens qui connaissent leur sujet, d’ailleurs parfois beaucoup mieux que certains théologiens. On trouvera ce bilan sans doute rude. Il rend compte en bonne partie des difficultés à nouer un véritable dialogue entre théologie et sciences sociales. Ne chargeons pas unilatéralement la barque. On en est aujourd’hui, et sans doute à la différence du dernier tiers du vingtième siècle, à une sorte de situation en miroir, l’ignorance mutuelle dans laquelle se tiennent souvent théologie et sciences sociales. Mais au lieu d’y voir d’abord des raisons idéologiques, les sciences sociales rejetant les théologiens en raison de leur foi, et ceux-ci ignorant les sciences sociales en raison de leur présupposé a-thée – par méthode –, il faut le rappeler, ne vaut-il pas la peine de s’interroger d’abord sur un écart entre ces disciplines dans le rapport aux finalités de la recherche, du moins telles que la conçoit l’institution ecclésiale, puisque c’est de ce côté que les RSR se situent ?